6 - Les programmes de satellites
6.2 - Les satellites de télécommunication
Les préliminaires
Depuis la fin du programme Symphonie, dont les deux satellites
ont été mis en orbite en 1974 et 1975, les industriels français
de l'espace attendent avec impatience que les administrations nationales
décident de la suite à lui donner.
Une expérience a été acquise dans le domaine des
télécommunications par satellites et, même si, pour
des raisons politiques, Symphonie n'a pu assurer une exploitation
commerciale, il a été démontré que les industriels
étaient capables de développer des solutions originales et
performantes. La durée de vie opérationnelle des satellites
dépassera finalement les prévisions initiales.
Un «lobbying» est entrepris pour que l'industrie française
puisse continuer d'occuper une position la plus forte possible dans un
domaine particulièrement prometteur.
À Thomson-CSF, les principales actions sont menées dès
1976 en direction de la DGT (Direction Générale des Télécommunications)
par une équipe composée de Michel Faingold, auquel succédera
Michel Lasalle, et de Gérard Coffinet, Directeur Commercial, à
partir de 1975, de la Division DFH. Avant de quitter cette Division, André
Lepeigneux a donné une impulsion de départ à ces actions.
Les administrations militaires, qui ont déjà passé
à Thomson-CSF (Département DSP) quelques marchés d'études
de faisabilité sur l'utilisation des satellites pour les télécommunications
militaires, sont l'objet de démarches visant à les persuader
qu'il est temps de passer aux réalisations concrètes.
Enfin, le CNES, qui a joué un rôle majeur dans le programme
Symphonie
et ne peut rester étranger à l'éventuelle mise en
oeuvre d'un système national de télécommunications
par satellites, fait également l'objet de pressantes démarches.
Bien que les interlocuteurs rencontrés dans les administrations
aient en général exprimé une certaine sympathie pour
les arguments exposés car ils ne sont, eux non plus, pas restés
inactifs depuis le succès du programme Symphonie, il faut
un certain temps avant que les intentions exprimées ne se matérialisent.
À un niveau différent, mais non sans énergie, car
le Département DSP vit alors sa «traversée du désert»,
sa Direction n'est pas restée inactive dans les démarches
auprès des administrations.
Au cours de l'année 1978, les orientations se précisent;
un programme national éventuel de télécommunications
par satellites utiliserait très probablement à la fois la
bande Ku et la bande C. Thomson-CSF est invité à présenter
des propositions d'études préliminaires, dont les marchés
devront être notifiés avant la fin de l'année. Le Département
DSP, avec l'assistance des services techniques de la Division DFH, prépare
des propositions sur ce que doivent être les points les plus difficiles
des études.
L'année 1978 se termine sans qu'aucun marché d'étude
n'ait été notifié. Heureusement, dès le début
de 1979, les événements se précipitent, et la décision
officielle d'un programme de satellites de télécommunications
national est annoncée le 20 février 1979, date de l'accord
donné par le Gouvernement. Il reste à choisir le maître
d'oeuvre et à préciser l'organisation industrielle.
A priori, rien n'empêche Thomson-CSF de se présenter
comme maître d'oeuvre potentiel car, après tout, il s'agit
d'un satellite de télécommunications. Cette voie n'est pas
retenue pour deux raisons, la première étant que dans l'esprit
des administrations françaises, les deux seuls industriels compétents
pour ce rôle sont MATRA et Aérospatiale, la seconde étant
que Thomson-CSF estime n'avoir pratiquement pas, au niveau national, de
concurrent valable pour la charge utile de télécommunications
et peut donc légitimement prétendre assurer cette responsabilité
auprès de l'un ou l'autre des maîtres d'oeuvre.
Cette optique est finalement retenue par la DGT et il est convenu qu'une
compétition sera ouverte entre MATRA et Aérospatiale pour
la maîtrise d'oeuvre du satellite, Thomson-CSF étant invitée
à proposer sa charge utile à chacun d'eux.
À la suite d'une demande de proposition émise par la DAII
(Direction des Affaires Industrielles et Internationales de la DGT)
le 13 avril 1979, un premier marché, dit de phase B, est notifié
à Thomson-CSF le 26 juillet 1979 pour l'étude de définition
préliminaire de la charge utile. Le chef de projet de cette étude,
menée par le Département DSP avec le concours des services
techniques de la Division DFH, est Maurice Dumas. En fait, les travaux
ont commencé par anticipation dès le mois de juin.
L'aboutissement de cette phase B est, outre un rapport de fin d'étude,
une proposition technique et industrielle qui doit être remise au
maître d'oeuvre pour être intégrée à sa
proposition pour le satellite complet.
Parallèlement, la compétition pour la maîtrise d'oeuvre
du satellite aboutit, le 21 septembre 1979, au choix de MATRA pour une
étude de phase B. La décision définitive concernant
les phases C et D sera prise «en fonction des résultats
de cette étude» qui, en particulier, doit «être
conduite dans le souci d'obtenir les meilleures contreparties à
l'exportation, y compris sur les charges utiles».
Avant que ce choix, d'abord prévu pour fin juillet 1979, ne soit
effectué, Thomson-CSF doit répondre à de nombreuses
questions de l'Administration sur ses conséquences dans divers domaines
tels que, par exemple, les avancées technologiques possibles, les
participations des industries étrangères, les perspectives
d'exportation de satellites dérivés de Telecom 1,
etc.
Dans ses réponses à de telles questions, Thomson-CSF s'efforce
toujours d'observer une stricte neutralité vis-à-vis des
deux sociétés concurrentes.
Les perspectives d'exportation de satellites dérivés de
Telecom
1 donnent lieu à la signature, au début de septembre
1979, d'un MOU (Memorandum Of Understanding) entre British Aerospace, MATRA
et Thomson. Ce MOU prévoit que, en cas de victoire de MATRA, les
trois sociétés s'engageront à négocier un accord
de coopération pour l'exportation de satellites dérivés
de Telecom 1.
Un MOU analogue a été signé fin août entre
Ford Aerospace, Aerospatiale et Thomson-CSF.
Une première réunion de «kick off» du programme
est tenue le 5 octobre 1979 avec le maître d'oeuvre et les diverses
administrations intéressées.
Les trois satellites objets du marché sont particulièrement
complexes. Les répéteurs composant la charge utile de télécommunications
doivent assurer les missions suivantes:
- cinq canaux en bande Ku (14/11 GHz) pour des liaisons de téléphonie
et de services spécialisés intra-entreprises, en France métropolitaine
et dans les pays limitrophes;
- un canal en bande Ku pour la distribution de programmes de télévision
et de vidéocommunication;
- quatre canaux en bande C (6/4 GHz) pour les liaisons téléphoniques
et la distribution de programmes de télévision entre la métropole
et les Dom-Tom;
- deux canaux en bande X (8/7 GHz) pour les communications gouvernementales
du système SYRACUSE (SYstème de RAdioCommunications
Utilisant un SatellitE).
Dans aucun satellite de télécommunications réalisé
jusqu'à cette époque on n'a pris le risque de faire cohabiter
trois bandes de fréquences en plus de la bande S utilisée
pour la télémesure et télécommande.
L'une des premières difficultés à résoudre
par les ingénieurs du groupe de projet mis en place à DSP
est de concevoir un plan de fréquences, à bord du satellite,
qui évite toute interférence.
La zone de couverture des antennes doit être adaptée à
chacune des missions:
- France et pays limitrophes pour la bande Ku;
- couverture «semi-globale» s'étendant de la Réunion
à la zone Antilles-Guyane, sans oublier Saint-Pierre-et-Miquelon,
pour la bande C;
- pinceau fin couvrant la zone Antilles-Guyane en bande C;
- couverture globale en bande X.
En plus de la charge utile de télécommunications, le Département
DSP doit fournir le sous-système de télémesure, télécommande
et localisation en bande S.
À l'instigation de l'Administration, Thomson s'assure les services,
en tant que consultant, de Hughes Aircraft, pour la définition de
la charge utile: cette requête est ouvertement justifiée par
l'organisme client comme devant réduire les risques dus au «manque
d'expérience» de l'industrie française.
En prenant connaissance des spécifications de la charge utile,
lorsqu'ils commencent leur travail au début de 1980, la première
réaction des représentants de Hughes Aircraft est de s'étonner
que l'on prenne le risque de faire cohabiter trois bandes de fréquences
dans la même charge utile. À leur avis, il vaudrait mieux
assurer les services prévus avec au moins deux satellites différents.
Après une continuation de la phase B en liaison avec le maître
d'oeuvre désigné, MATRA, et avec l'assistance technique de
Hughes, la phase de réalisation démarre effectivement en
juin 1980, le marché avec les administrations n'étant signé
que le 31 décembre 1980 pour deux satellites à lancer plus
un modèle de réserve au sol.
Pour ce marché, Thomson-CSF, dont la participation sera supérieure
à la moitié du total, a demandé à être
conjoint avec le maître d'oeuvre. L'Aérospatiale a accepté
cette demande, mais MATRA, qui sera finalement choisi, a refusé,
malgré les souhaits de la DGT. Thomson-CSF est donc sous-traitant
désigné, avec paiement direct, et MATRA est titulaire du
contrat.
La négociation donne lieu à quelques péripéties
dont certaines auront des conséquences fâcheuses sur la rentabilité
du programme à Thomson-CSF. Le Service Commercial de la Division
DFH a une longue expérience des négociations avec l'administration
des PTT et pourrait, dans une formule conjointe, en faire bénéficier
MATRA. Ce ne sera malheureusement pas le cas.
En particulier, une clause imposée par l'Administration transforme
une part non négligeable des paiements en «primes de vol»
payables seulement en cas de fonctionnement correct, et un an après
la mise en orbite de chacun des deux premiers modèles de vol. Pour
Thomson-CSF, cela représente 33 millions de francs, soit plus de
10 % du prix de sa fourniture. Le Service Commercial du Département
DSP, chargé d'établir le devis, n'a pas été
prévenu en temps utile de l'existence de la clause et n'a donc pas
été en mesure d'en tenir compte dans l'évaluation
des frais financiers.
Ce n'est que trois ans après la livraison du premier modèle
de vol de la charge utile que DSP pourra récupérer en totalité
les 33 millions de francs manquants avec, sur la totalité de l'affaire,
une marge sérieusement entamée.
Cette formule d'intéressement sous la forme de «primes
de vol» sera, par la suite, généralisée dans
la plupart des programmes de satellites en étant, à chaque
fois, précisée dans les appels d'offres, ce qui permettra,
à la différence de Telecom 1, d'en prévoir
les conséquences.
Le programme Telecom 1, outre le satellite, comprend la réalisation
de stations terriennes auxquelles s'intéressent la filiale Telspace,
chargée de ce domaine, ainsi que la Division Faisceaux Hertziens
(DFH) qui doit fournir une grande partie des matériels de ces stations.
Une Direction du Programme est créée au niveau de la Division
DFH et confiée à Jean-Louis de Montlivault, nouvellement
embauché en provenance de l'ESA, qui doit superviser l'exécution
de l'ensemble des marchés: charge utile du satellite, stations terriennes
et mise en place du réseau militaire SYRACUSE associé
à la charge utile militaire du satellite.
Le déroulement du programme à DSP
L'arrivée du programme Telecom 1 est à l'origine
d'une expansion très rapide du Département DSP qui, depuis
1976, a dû réduire ses effectifs au minimum acceptable pour
avoir des chances de redémarrer. Il faut embaucher rapidement et
former les nouveaux arrivants.
Le problème des surfaces industrielles devient rapidement critique
et il est nécessaire de trouver de nouveaux locaux temporaires (Texas,
La Boursidière, Les Mureaux) tout en prospectant pour une nouvelle
implantation (Cergy, Toulouse…), en principe définitive.
Devant les risques courus à cause d'une expansion trop rapide,
il apparaît raisonnable de limiter ceux-ci en sous-traitant une partie
de la charge utile.
Les répéteurs en bande X (8/7 GHz), destinés aux
télécommunications gouvernementales, sont choisis pour cette
sous-traitance en plein accord avec les administrations clientes. Les raisons
de ce choix sont, en premier lieu, qu'il semble relativement facile de
trouver, aux États-Unis, des matériels quasi «standard»
opérant dans cette bande, et ensuite que cette décision préserve
les chances de DSP d'étendre son expérience dans les bande
C et Ku, dans le domaine très prometteur des télécommunications
civiles.
Les sous-traitances à Ford Aerospace
Trois industriels américains, connus pour avoir réalisé
des matériels en bande X, sont consultés: Hughes Aircraft,
Ford Aerospace et TRW. Hughes ne manifestant pas un réel intérêt
pour cette affaire, la compétition sera limitée à
Ford et TRW, et c'est Ford qui l'emportera.
On voit alors se créer une situation inédite: alors que
dans toutes les affaires de satellites de télécommunications
précédentes, et en particulier pour Intelsat, les
maîtres d'oeuvre ont été américains, les Européens
se contentent du rôle de sous-traitants. Cette fois-ci, le maître
d'oeuvre est français, donc a priori moins expérimenté,
alors que le sous-traitant est américain, c'est-à-dire, a
priori, plus expérimenté. Cette situation, qui ne pose
pas de problème important tant que l'affaire se déroule normalement,
a cependant pour résultat, lorsqu'une difficulté surgit,
une certaine réticence de la part de Ford à accepter les
observations des représentants de Thomson. Beaucoup d'opiniâtreté
est souvent nécessaire à ces derniers pour obtenir gain de
cause.
Le principal incident se produit tout au début de l'affaire.
Le contrat entre Ford et Thomson est paraphé par les deux parties
le 29 août 1980. Ford repousse ensuite la signature finale pendant
trois mois, conditionnant celle-ci à une modification de la spécification
sur la distorsion de phase.
En novembre 1980, Ford annonce la nécessité de trouver
une solution de remplacement à un transistor à effet de champ
dont le fournisseur a arrêté la fabrication. Début
décembre, Ford confirme qu'il doit s'orienter vers une solution
de remplacement et en indique les conséquences sur les coûts,
délais et performances.
Après une dure négociation, le contrat est enfin signé
le 13 décembre 1980, moyennant une augmentation de prix non négligeable:
650 000 dollars.
La suite de l'exécution du contrat se déroule sans incident
majeur sous l'oeil vigilant des ingénieurs résidents de DSP
à Palo Alto: Jean Ramis et Jacques Haydont, et les matériels
sont livrés dans les délais prévus.
D'autres matériels seront également sous-traités
à Ford: les alimentations (EPC) pour les tubes à ondes progressives
des répéteurs en bande Ku (12 GHz). Ces alimentations sont
supposées être très voisines de celles que Ford a fournies
en grande quantité pour les satellites Intelsat V.
Dans le cadre de cette fourniture, un incident notable mérite
d'être signalé, qui démontre que la rigueur adoptée
par DSP vis-à-vis de ses sous-traitants, même ayant des références
supérieures aux siennes, est loin d'être inutile.
Au cours d'essais de vide thermique effectués en 1982, des anomalies
de fonctionnement sont constatées sur le transformateur haute tension
de l'EPC qui, en principe, d'après Ford, est supposé être
qualifié par analogie avec celui d'Intelsat V.
À haute température et à la pression critique,
des disjonctions se produisent. Une longue analyse de défaillance
permet de constater l'apparition de fissures dans le matériau isolant
au voisinage de la température maximale d'essais, dues à
des dilatations différentielles. Des alimentations déjà
livrées sont reprises par Ford pour adjonction de dissipateurs thermiques
et le fournisseur doit relancer la fabrication d'un nouveau lot pour remplacer
les transformateurs où des fissures ont été constatées.
Ces sous-traitances à Ford Aerospace permettent à DSP
d'effectuer un bon apprentissage des méthodes à utiliser
pour mener à bien une sous-traitance à un grand industriel
américain.
Les antennes
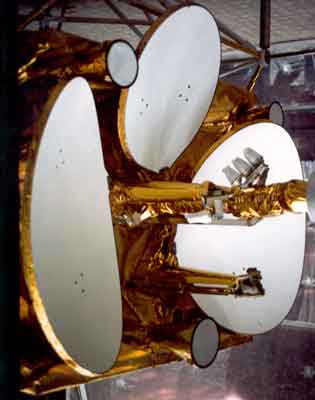 Le
sous-système «antennes» de Telecom 1 comprend
six antennes indépendantes: trois cornets et trois antennes à
réflecteurs. Le
sous-système «antennes» de Telecom 1 comprend
six antennes indépendantes: trois cornets et trois antennes à
réflecteurs.
Deux cornets assurent respectivement l'émission et la réception
en bande X, le troisième étant consacré à la
réception en bande C. Tous assurent une couverture globale.
La conception de ces trois cornets «corrugués» est
largement déduite de celle du cornet de réception en bande
C du satellite Symphonie. Leur étude et leur réalisation
ne se heurtent à aucun problème particulier.Les trois antennes
à réflecteurs se répartissent les fonctions suivantes:
- émission en bande C vers la France et les Dom-Tom (antenne
dite «semi-globale»);
- réception des six canaux en bande Ku en provenance de la métropole
et émission vers cette même couverture des canaux pairs en
bande Ku (antenne dite «14/12»);
- émission vers la métropole des canaux impairs en bande
Ku et émission d'un pinceau fin en bande C vers la zone Antilles-Guyane
(antenne dite «4/12»).
L'ensemble des antennes est entièrement réalisé
au Département DSP, à l'exception des réflecteurs
en fibres de carbone, sous-traités à l'Aérospatiale.
Cette dernière est également chargée d'effectuer les
essais d'environnement des antennes complètes.
 La
source d'alimentation de l'antenne semi-globale donne l'occasion au laboratoire
Antennes de DSP de transformer en réalisations concrètes
les études d'antennes multisources qui ont commencé quelques
années auparavant, à l'occasion d'une proposition pour le
satellite brésilien. La
source d'alimentation de l'antenne semi-globale donne l'occasion au laboratoire
Antennes de DSP de transformer en réalisations concrètes
les études d'antennes multisources qui ont commencé quelques
années auparavant, à l'occasion d'une proposition pour le
satellite brésilien.
La seule difficulté notable rencontrée dans le domaine
radioélectrique concerne l'alimentation de la source de l'antenne
semi-globale qui, prévue initialement en câble coaxial, doit
finalement être remplacée par un guide d'ondes.
Par contre, la mise au point mécanique des réflecteurs,
puis de l'ensemble de chacune des antennes, donne lieu à de multiples
difficultés qui ne seront résolues qu'au prix de retards
sur les délais de livraison contractuels, ces derniers n'entraînant
heureusement pas de retard sur la livraison du premier modèle de
vol de la charge utile.
Il apparaît rapidement que les logiciels utilisés initialement
par l'Aérospatiale pour étudier les déformations thermoélastiques
des réflecteurs et des supports, particulièrement critiques
pour la stabilité des diagrammes de rayonnement et des directions
de pointage, ne sont que partiellement adaptés aux problèmes
à résoudre. De plus, DSP ne possède pas, à
l'époque, de compétences suffisantes pour superviser ce type
de travail.
Par approximations successives, et après des efforts méritoires
tant du côté de l'Aérospatiale que de celui de DSP,
les problèmes finissent par être résolus. Les antennes
sont conformes aux spécifications, et leur comportement en orbite
est conforme aux prévisions.
Les répéteurs «civils»
Bénéficiant de l'expérience acquise au cours
des études et réalisations faites pour les satellites Symphonie,
OTS et TDRSS, ainsi qu'au cours de l'exécution de marchés
d'étude obtenus auprès de l'organisation Intelsat, le développement
des répéteurs permet de matérialiser quelques innovations
technologiques. L'une d'elles consiste dans la réalisation de filtres
en fibres de carbone pour la bande C.

|
Multiplexeur de sortie (OMUX) de Telecom 1 en bande C
Technologies fibre de carbone
|
 Les
études de base de cette technologie ont été faites
dans le cadre d'un contrat d'aide au développement attribué
par le ministère de l'Industrie. Quelques informations ont été
obtenues par Francis Violet au cours d'une mission aux États-Unis
mais, pour Jacques Urien, responsable de l'étude et du développement,
quelques «pièges» subsistent. Faire adhérer la
dorure aux parois internes des guides d'ondes et faire ensuite en sorte
qu'elle ne se décolle pas sous l'effet des cycles thermiques n'est
pas de tout repos. Il faut supporter quelques déceptions avant d'obtenir,
par une expérimentation minutieuse, des résultats reproductibles. Les
études de base de cette technologie ont été faites
dans le cadre d'un contrat d'aide au développement attribué
par le ministère de l'Industrie. Quelques informations ont été
obtenues par Francis Violet au cours d'une mission aux États-Unis
mais, pour Jacques Urien, responsable de l'étude et du développement,
quelques «pièges» subsistent. Faire adhérer la
dorure aux parois internes des guides d'ondes et faire ensuite en sorte
qu'elle ne se décolle pas sous l'effet des cycles thermiques n'est
pas de tout repos. Il faut supporter quelques déceptions avant d'obtenir,
par une expérimentation minutieuse, des résultats reproductibles.
Pour «draper» le tissu de fibres sur les mandrins, une opératrice
est spécialement formée.
Le problème de l'humidité n'est pas le moindre. Un filtre
réglé en atmosphère ambiante voit ses dimensions varier
au cours des essais sous vide. Il faut donc tenir compte de ces variations
pour le réglage, et réaliser ensuite une enveloppe étanche
permettant de maintenir un certain niveau de dessiccation pendant le séjour
des filtres dans l'atmosphère terrestre avant le lancement du satellite.
L'un après l'autre, tous ces problèmes sont patiemment
résolus, et c'est en grande partie grâce à la technologie
des filtres en fibres de carbone pour les répéteurs en bande
C que la charge utile de Telecom 1 peut satisfaire aux spécifications
de masse.
Pour les filtres en bande Ku, dont les dimensions géométriques
sont plus petites, la fibre de carbone n'amène pas un avantage déterminant
et la technologie utilisée est celle de l'Invar mince. Elle est
développée à Levallois, par la Division DFH qui ajoute
cette contribution à celle, très importante, qu'elle apporte
dans les études des autres circuits des répéteurs.

|
Multiplexeur de sortie (OMUX) de Telecom 1 en bande
Ku
Technologies invar mince
|
 La
collaboration entre DFH et DSP dans le cycle allant des études aux
réalisations des matériels de répéteurs a été
«rodée» au cours des programmes précédents;
il y a, bien entendu, quelques désaccords momentanés qui
sont vite résolus, en grande partie grâce à l'action
de Pierre de Bayser qui, étant passé de DFH Levallois à
DSP Meudon en octobre 1979, connaît suffisamment les deux unités
pour régler rapidement les problèmes, en général
mineurs, qui peuvent survenir entre elles. La
collaboration entre DFH et DSP dans le cycle allant des études aux
réalisations des matériels de répéteurs a été
«rodée» au cours des programmes précédents;
il y a, bien entendu, quelques désaccords momentanés qui
sont vite résolus, en grande partie grâce à l'action
de Pierre de Bayser qui, étant passé de DFH Levallois à
DSP Meudon en octobre 1979, connaît suffisamment les deux unités
pour régler rapidement les problèmes, en général
mineurs, qui peuvent survenir entre elles.
Les études, le développement et les essais des répéteurs
de Telecom 1 ne donnent lieu qu'à peu d'incidents notables.
Le décollement d'un bloc de ferrite dans un isolateur au cours
d'un essai de qualification en septembre 1982 est à l'origine d'une
analyse de défaillance et à des essais de vieillissement
accéléré, dont les conclusions aboutissent à
un renforcement des précautions prises au cours du montage et à
des essais supplémentaires de déverminage.
Les premiers essais des oscillateurs locaux font craindre que les spécifications
de stabilité de fréquence sur sept ans ne soient pas tenues.
Des analyses théoriques et expérimentales, conduites à
partir du début de l'année 1983, mettent en évidence
quelques défauts de conception et de réalisation auxquels
il est remédié sans que cela n'affecte les délais
de livraison. Finalement, le comportement en orbite des oscillateurs locaux
s'avérera conforme aux spécifications.
Enfin, quelques tâtonnements seront nécessaires pour ajuster
les tensions de chauffage des cathodes des TOP à 12 et 7 GHz afin
d'assurer des durées de vie optimales.
Des modifications aux EPC sont finalement décidées et
aboutissent à des interventions à partir du début
de 1984, alors que le prototype de vol numéro un (PV1) et la charge
utile du MV2 sont déjà intégrés. Il s'agit
de modifier et d'ajouter des résistances de réglage. Au total,
vingt ATOP seront modifiés de janvier à juin 1984, dont neuf
au niveau du satellite intégré, sans démontage total
de l'équipement.
Ce n'est qu'au prix de rigoureuses procédures établies
avec le plus grand soin que ces modifications peuvent être effectuées
sans incident notable.
L'intégration
Deux types d'intégration sont effectués par ATES (Alcatel
Espace):
- la préintégration du sous-système télémesure-télécommande,
avant livraison au maître d'oeuvre MATRA. Cette opération,
pour laquelle le Service ES a acquis une bonne expérience dans les
programmes précédents, ne donnera lieu à aucun commentaire
particulier;
- l'intégration de la charge utile de télécommunications,
qui constitue un pas nouveau dans l'expansion du domaine de compétences
d'ATES.
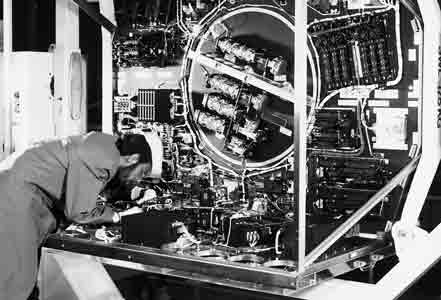
|
|
La charge utile de Telecom 1
|
Dans le programme précédent, Symphonie,
les premières préintégrations des charges utiles ont
été dirigées par Siemens pour le MI et le MV1, avec
la participation de représentants de Thomson (DSP), alors que Thomson
a ensuite intégré les charges utiles du MQ et du MV2 avec
la participation de Siemens. Les intégrations finales dans le satellite
ont ensuite été conduites à l'Aérospatiale
par des équipes de plusieurs sociétés.
Pour Telecom 1, ATES reçoit du maître d'oeuvre MATRA,
pour chaque modèle, la partie de la structure devant supporter la
charge utile, et prend l'entière responsabilité de l'intégration
de cette dernière.
L'expérience récemment acquise dans le programme TDRSS
pour la réalisation et la mise en oeuvre de bancs de tests automatiques
est mise à profit, cette fois au niveau d'une charge utile complète.

|
|
L'équipe d'intégration de Telecom 1
|
C'est à Philippe Gsell, qui a fait ses premières armes
dans l'intégration de Symphonie, qu'est confiée la
responsabilité de l'intégration, tandis que Jean-Claude Lestriez,
qui a eu la charge des essais des récepteurs de TDRSS, dirige
la conception et la mise en oeuvre des bancs de tests.
Une autre innovation est expérimentée à l'occasion
de Telecom 1: le modèle de qualification (MQ), qui, dans
la plupart des programmes précédents, n'était plus
utilisé après avoir subi les essais dits de qualification,
doit, dans le programme Telecom 1, être utilisé comme
modèle de vol, avec le nom de prototype de vol numéro un
(PV1) après avoir subi, autant que nécessaire, une remise
en état après les essais de qualification.

|
|
Assembage de la charge utile de Telecom 1
|
Cette procédure, destinée à faire l'économie
d'un modèle, se généralisera dans la plupart des programmes
ultérieurs.
Les livraisons et les lancements
La charge utile du PV1 est intégrée à Toulouse
à partir de juin 1982 et livrée à MATRA le 9 juillet
1983.
Le satellite Telecom 1A est lancé de Kourou le 4 août
1984. Pour les autres modèles, les dates sont les suivantes:
- intégration de la charge utile du MV2 à Toulouse: juillet
à décembre 1983;
- lancement de Telecom 1B: 8 mai 1985;
- intégration de la charge utile du MV3 à Toulouse: janvier
1984 à février 1985;
- lancement de Telecom 1C: 11 mars 1988.
 
En raison de la longue durée du programme, plusieurs chefs de
projet successifs assumeront cette responsabilité pour la charge
utile. Après Maurice Dumas, qui dirige la phase B à partir
d'avril 1979, Philippe Blanchet prend la direction, de novembre 1979 à
octobre 1981. Il est remplacé en octobre 1981 par Bruno Blachier
auquel succéderont Jacques Beaucher de novembre 1982 à mai
1985, puis Pierre Jaubert de mai 1985 à la fin du programme, après
le lancement de Telecom 1C, en 1988.
La vie en orbite
Pour chacun des trois modèles de vol, les opérations
de recette en orbite permettent de constater des performances conformes
aux spécifications, à quelques détails près.
Cependant, pour le premier modèle, Telecom 1A, des incidents
répétés font grand bruit. Environ une fois par jour
après la mise sous tension des répéteurs, des disjonctions
intempestives se produisent sur au moins un des ATOP à 7 GHz et,
plus rarement, sur certains ATOP à 12 GHz.
Le phénomène causant ces interruptions est rapidement
identifié comme étant le même qui avait causé
des commutations intempestives sur le premier modèle de Symphonie:
les surfaces conductrices du satellite ne sont pas équipotentielles,
et les champs transitoires créés par des arcs électriques
induisent des signaux parasites dans certains circuits de télécommande.
Après chaque interruption, quelques minutes sont nécessaires
pour mettre en oeuvre la séquence de remise sous tension du TOP concerné.
Le malheur veut qu'une haute personnalité de la Défense
nationale exprime le désir d'utiliser un circuit téléphonique
passant par Telecom 1A juste au moment où une disjonction
vient de se produire. Le problème technique à résoudre
est instantanément devenu une affaire d'État !
Pour Telecom 1A, il n'existe aucun remède. Pour les modèles
suivants, le maître d'oeuvre réalise les connexions nécessaires
pour que la surface extérieure du satellite soit effectivement équipotentielle.
À titre de précaution supplémentaire, on modifie certaines
parties du câblage de la charge utile afin d'éviter la formation
de boucles captant l'énergie parasite, et on dispose des filtres
sur les connexions filaires à l'entrée des alimentations
des TOP. Aucun incident de ce genre ne se produira sur Telecom 1B
ni sur Telecom 1C.
Telecom 1A et Telecom 1C assureront tous deux leur service
au-delà de leur durée de vie nominale de sept ans. Telecom
1B sera mis hors service le 15 janvier 1988 à la suite d'une
panne survenue dans l'alimentation de son système de contrôle
d'attitude.
 
|